Des troubles du comportement alimentaire aux troubles de la socialisation alimentaire
#ZOOM SUR...
Professeur de sociologie à l’université de Toulouse - Jean Jaurès, titulaire de la chaire Food, Cultures and Health, créée conjointement par la Taylor's University de Kuala Lumpur (Malaisie) et l'Université de Toulouse Jean-Jaurès, Jean-Pierre Poulain est membre du Centre d'Étude et de Recherche Travail Organisation Pouvoir (CERTOP, UMR5044, CNRS / Université Toulouse - Jean Jaurès / Université Toulouse III - Paul Sabatier. Ses recherches portent notamment sur la sociologie et l’anthropologie de l’alimentation et des cultures alimentaires, sur les pratiques alimentaires, sur les problèmes sociaux liés à l’obésité, sur les troubles du comportement alimentaire, sur la gestion des crises alimentaires.
Le Diagnostic and Statistical Manual (DSM), publié par l’association américaine de psychiatrie, qui propose des définitions des maladies mentales, s’est imposé comme une référence dans l’univers médical. Définitions strictement descriptives et statistiques (le ‘S’ de DSM), car ce document se veut athéorique et entend se positionner au-delà des tensions concurrentes qui structurent ce champ scientifique, à savoir : la lecture psychanalytique qui recherche l’origine du trouble dans l’histoire du sujet ; l’étiologie neurologique pour qui le problème est un dysfonctionnement neurophysiologique ; et la santé communautaire, qui postule que les conditions de vie sont des déterminants de la santé mentale1 .
En 1994, le DSM IV décrit les Troubles du comportement alimentaire (TCA) en trois catégories : l’anorexie mentale, la boulimie et les « autres états ». Or, il est apparu que cette dernière catégorie représentait statistiquement plus de 50 % des troubles. La version suivante, le DSM V de 2013, introduit de nouvelles catégories : l’hyperphagie boulimique ; l’alimentation sélective ; le pica (ingestion de substances non comestibles) ; le mérycisme (phénomène de « rumination », c’est-à-dire de régurgitation et de remastication). La Classification internationale des maladies (CIM), dont le champ d’application est la médecine en général, a largement repris les définitions du DSM, leur ajoutant au fur et à mesure des éditions la « boulimie atypique », « l’hyperphagie associée à d’autres perturbations physiologiques », les « vomissements associés à d’autres perturbations psychologiques », tout en conservant une catégorie « autres troubles de l’alimentation ».
La construction conceptuelle des TCA s’inscrit donc dans le mouvement de la médicalisation dans une double réductionnisme de l’alimentation : sa dimension comportementale et ses composants nutritionnels (nutritionnalisation).
Le regard des sciences sociales sur les TCA
L’étude sociologique des TCA fut, tout d’abord, une mise en question d’une loi bien établie des inégalités de santé, pour laquelle la prévalence et la gravité des pathologies suivent un gradient inverse à la hiérarchie sociale. La fréquence des TCA, tels que définis par la psychiatrie, est en effet plus importante dans le milieu et le haut de l’échelle sociale. Elle est également associée à des trajectoires intergénérationnelles ascendantes. Enfin, on constate également une asymétrie de genre, les femmes étant plus concernées, et un lien inverse avec l’âge, la fréquence diminuant avec le vieillissement. Ainsi l’anorexie concerne-t-elle plus souvent des jeunes femmes en ascension intergénérationnelle.
Les interprétations sociologiques proposées, plus complémentaires que concurrentes, voient les TCA comme une réponse à la pression du modèle de minceur, comme un usage pathologique des normes d’excellence, qui conduisent les individus concernés à surinvestir les critères de la réussite, parmi lesquels se trouverait la minceur. Enfin, pour certains, les TCA seraient une conséquence des tensions sociales concentrées sur des segments particuliers de la population, en termes d’âge, de sexe et de position sociale.
Cependant, l’obésité, elle-même associée plus ou moins explicitement à certains TCA, est venue complexifier les choses. À l’échelle macro, avec une prévalence plus importante en bas de l’échelle sociale, elle est bien conforme à la règle générale des inégalités de santé. Ce paradoxe a conduit à l’idée que plusieurs types d’obésité pouvaient être identifiés au sein de la population concernée : certains types associés à des TCA étant en partie indépendants des positions sociales et d’autres affichant de fortes prévalences sur le bas de l’échelle sociale, associées à la précarisation ou encore à des trajections migratoires transitionnelles2 .
Des Troubles du comportement alimentaire (TCA) aux Troubles de la socialisation alimentaire (TSA)
Le concept de socialisation alimentaire a une double signification. Il renvoie tout d’abord au fait que manger est un acte socialisé. Il suppose en amont une « orchestration sociale », c’est-à-dire une coordination des emplois du temps et des pratiques pour que les individus se retrouvent pour manger ensemble. Pendant les repas, l’alimentation est le support, le prétexte à des interactions sociales. Ils sont des moments de commensalité, de plaisir partagé, mais aussi parfois de conflictualité. Ils sont un espace de régulation de la vie de la famille.
Dans un second sens, le terme « socialisation » met l’accent sur le fait que ce que nous mangeons et l’acte alimentaire lui-même sont socialement et culturellement définis. L’alimentation est donc l’objet d’un ensemble de normes sociales et de manières, qui varient au sein d’une société en fonction des positions sociales. L’intériorisation de ces règles et de ces normes permet à un enfant de manger en société et d’y ‘prendre place’ (se servir des outils, contrôler son corps, la place et les formes du plaisir socialement acceptables, etc.). Le processus de socialisation correspond ainsi à la façon dont ces normes et ces règles sont intériorisées par l’individu ainsi qu’aux modalités de leur intériorisation.
L’intérêt du concept de socialisation alimentaire est de déplacer le regard des conduites ou des comportements vers les interactions sociales et les processus d’intériorisation des normes. En sociologisant la question, les troubles du comportement alimentaire deviennent troubles de la socialisation alimentaire au double sens du mot. Enfin, l’entrée par la socialisation alimentaire permet d’envisager les conséquences sur la vie familiale d’éventuels troubles d’un des membres de la famille.
Néophobie et socialisation alimentaire
Au cours du développement de l’enfant, le registre alimentaire évolue. C’est d’abord le lait, consommé dans un corps-à-corps et une communication avec la mère ou le parent nourricier. Dans un second temps sont introduits les aliments liquides et solides qui appartiennent au registre alimentaire de la famille, de sa position sociale et de sa culture, aliments que l’enfant accepte le plus souvent sans problème. Dans une troisième étape, l’enfant refuse certains aliments et engage avec les parents des « rapports de force ». Son registre alimentaire se réduit. L’opposition a pour enjeu sa reconnaissance par les parents et par la fratrie en tant que personne ayant des goûts, des dégoûts et des préférences. Ce moment correspond à peu près à la période que le psychologue René Spitz nomme le stade du « non »3 . Ces interactions et les négociations qui les accompagnent participent non seulement à la personnalisation de l’enfant, mais aussi à l’intériorisation des normes sociales alimentaires. À la sortie de ce stade, le registre du mangeable s’ouvre de nouveau et se stabilise en tenant compte de certaines préférences4 .
Cette grille de lecture a été utilisée dans une perspective interdisciplinaire pour décrire les « difficultés alimentaires » des enfants avec autisme. Une typologie de déformation du cycle néophobe dans cette population a pu être mise en évidence5 .
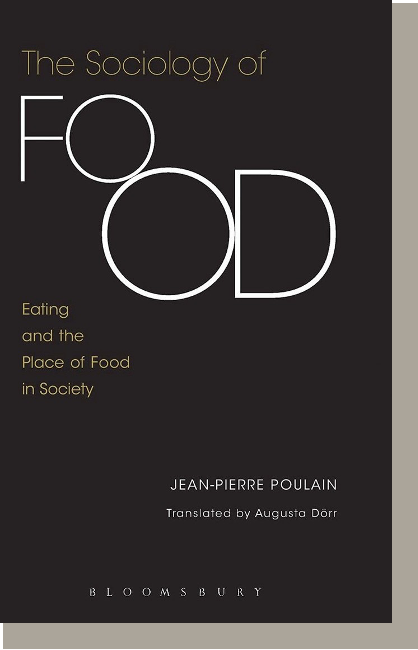
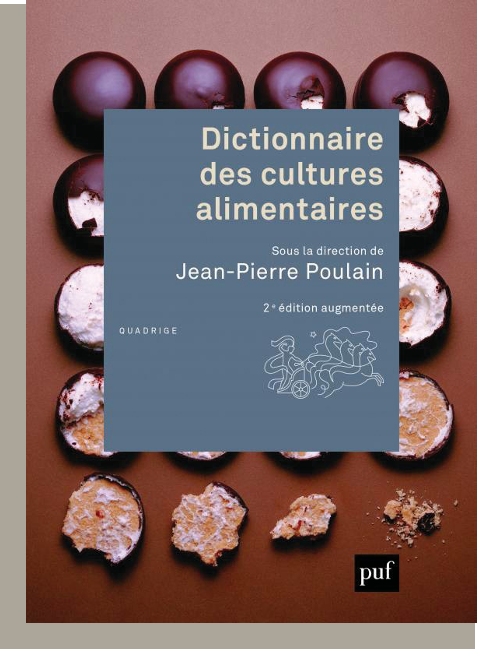
La socialisation alimentaire des enfants avec un syndrome de Prader Willi
Le syndrome de Prader Willi (SPW) est une maladie rare d’origine génétique qui se caractérise par des troubles de l'alimentation. À la naissance, les enfants sont hypotoniques et rencontrent des difficultés à téter. La succion et la déglutition doivent alors être stimulées. Les spécialistes parlent d’une forme d’anorexie. Vient ensuite une période où ils s’alimentent normalement, jusqu’au jour où tous, à des âges compris entre trois à cinq ans, basculent dans des prises alimentaires incontrôlables et incontrôlées. La maladie se manifeste principalement par une hyperphagie à mesure que le sujet vieillit, provoquant souvent une obésité sévère. Les formes de comportement sont variées, allant jusqu’au vol et à l’agressivité. Ces enfants réactualisent dans leur trajectoire de vie à la fois la problématique de l’anorexie et celle de la boulimie. En quoi cette maladie perturbe-t-elle l’intériorisation des normes, qui fonctionne habituellement dans le silence chez l’enfant indemne du syndrome ? Telle est la question qui anime les travaux de recherche d’Amandine Rochedy et de Jean-Pierre Poulain, développés en partenariat avec le centre de référence du syndrome de Prader Willi du CHU de Toulouse dirigé par Maithé Tauber ; ils ont permis de reproblématiser la question des « difficultés » alimentaires des enfants atteints de ce syndrome, en portant l’attention sur le processus d’intériorisation des normes sociales de l’alimentation6 .
Du point de vue méthodologique, la recherche se déroule en trois temps. Elle démarre d’abord par une phase d’observation ethnographique et d’entretiens au sein des familles dont un enfant est atteint du SPW. Puis, au sein de la plateforme Ovalie7 du CERTOP, est reconstitué un repas familial dans lequel les parents et la fratrie jouent leur propre rôle. Le repas est enregistré par les nombreuses caméras et dispositifs de captation. Des éléments filmés sont ensuite sélectionnés, et visionnés avec l’enfant, puis avec la famille, pour devenir le support d’un entretien réflexif collectif. Des échanges permettent de commenter et d’analyser ce qu’il s’est passé. Dans une dernière étape, se met en place un dialogue qui, affichant l’éducation thérapeutique pour horizon, confère une expertise aux parents ayant suivi l’ensemble du processus. Ce changement de registre les conduit à prendre de la distance et à modifier leur regard sur leurs propres pratiques. Avec eux, il s’agit d’identifier des formes de gestion de la vie quotidienne découvertes au fil d’essais et d’erreurs, qui pourraient trouver place au sein d’un portefeuille de stratégies et d’actions. Bien évidemment, ces solutions ne sont pas indépendantes des positions sociales des parents et de leur capacité à mobiliser des ressources matérielles et cognitives, et ces dimensions font partie du travail réflexif.
La prise en charge médicale actuelle permet d’éviter que ces enfants ne deviennent pour la plupart obèses : ceux-ci sont entourés d’un système de normes très strictes contrôlées par les parents, lesquelles, à la manière d’un exosquelette, accompagnent les gestes et les comportements de l’enfant.
Un exemple de scène filmée : l’un de ces enfants regarde des abricots prévus pour le dessert. Le père, en face, s’en rend compte et lui demande : « Lequel voudrais-tu ? ». L’enfant répond : « Le plus gros ». Le père relance alors l’échange : « Sais-tu comment on reconnait un bon abricot ? » S’engage alors une discussion entre les deux, qui détourne momentanément l’enfant de la prise alimentaire quantitative, et le déplace sur le terrain du goût et du plaisir. Quand on visionne avec eux ce moment, une émotion se libère en même temps qu’une réflexion s’élabore. L’aliment est sorti de sa stricte dimension nutritionnelle et le rôle du parent de sa fonction de contrôle.
D’un point de vue théorique, ces recherches permettent d’observer les dysfonctionnements de l’intériorisation des normes, au point qu’on doive les extérioriser de manière presque coercitive, ce qui est éminemment fatigant et compliqué pour les familles, voire leurs proches s’ils sont invités à table. Il s’agit de sortir d’une interprétation en termes de dysfonctionnement centré sur l’enfant, pour se déplacer vers les interactions entre le groupe social et l’enfant, comme espace d’intériorisation des normes. Cela a notamment pour effet que la relation conflictuelle, très prégnante dans ces familles, n’est plus surpathologisée, mais relève en partie d’un processus normal, renvoyant à ce que toutes les familles connaissent quand l’enfant est au stade de la néophobie.
En se concentrant sur les enjeux posés par l'intériorisation des normes sociales relatives à l'alimentation, la re-problématisation proposée articule l'approche du trouble alimentaire en lui-même avec l'approche de la prise en charge familiale. Cette nouvelle perspective met l'accent sur le rôle des interactions sociales dans le processus d'intériorisation, y compris les interactions conflictuelles.
Des questions interdisciplinaires émergent. Les difficultés d'intériorisation pourraient être le point de départ d'une nouvelle description du phénotype. De même, en tenant compte des étapes de la trajectoire du trouble alimentaire associé au SPW, de l'anorexie à l’hyperphagie, pourraient être imaginées des stratégies d'éducation alimentaire adaptatives et évolutives. Enfin et surtout, dans le champ de la dialectique traditionnelle du normal et du pathologique, qui a montré comment les connaissances développées sur le second peuvent permettre d’approfondir les connaissances sur le premier, on peut espérer ici de tels développements. En clair, examiner les troubles de la socialisation alimentaires chez les enfants avec un syndrome de PW, en focalisant sur le phénomène d'intériorisation des normes sociales dans le cadre d'une théorie générale de la socialisation alimentaire, pourrait non seulement ouvrir de nouveaux champs de recherche pour l’étude des autres troubles alimentaires, mais aussi permettre le développement des connaissances pour les enfants ‘typiques’. Dans un contexte où les autorités de santé publique posent l’obésité au premier rang des problèmes contemporains, ces avancées pourraient se révéler d’une certaine utilité.
- 1Demazeux S., Singy P. (eds.) 2015, The DSM-5 in perspective: philosophical reflections on the psychiatric Babel (Vol. 10), Springer.
- 2Poulain J-P. 2009, Sociologie de l’obésité, 2009.
- 3Spitz R. 2008, Le Non et le Oui, PUF.
- 4Poulain J-P. 2012, Néophobie alimentaire, in Poulain J-P., Dictionnaire des cultures alimentaires, PUF, pp. 981-983 ; Rochedy A., Poulain J-P. 2015, Approche sociologique des néophobies alimentaires chez l’enfant, Dialogue 209 : 55-68.
- 5Rochedy A., Raynaud J-P., Maffre T., Poulain J-P. 2020, « (Dé)formations du processus de néophobie. Une approche sociologique des particularités alimentaires des enfants avec un trouble du spectre autistique », Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence. https://doi.org/10.1016/j.neurenf.2020.06.001.
- 6Le programme « Socialisation des pratiques alimentaires des enfants avec un syndrome de Prader-Willi » (SOPAP), conduit par A. Rochedy (sociologue), M. Valette (nutritionniste), M. Guionnet (informaticien), M. Tauber (pédiatre) et J.P. Poulain (sociologue), est financé par la Fondation des maladies rares et l’association Prader Willi (France). Cette recherche a été également sélectionnée dans le cadre du programme Hubert Curien « Hibiscus », France-Malaisie, pour le développement d’une recherche en miroir entre le Social Behavioural Lab de la Taylor’s University de Kuala Lumpur et la Plateforme OVALIE du CERTOP.
- 7Poulain J-P., Simoulin V. 2016, « OVALIE. Quand les SHS se mettent aux plateformes expérimentales », La lettre de l’INSHS n°43 : pp. 13-15.https://www.inshs.cnrs.fr/sites/institut_inshs/files/download-file/lettre_infoinshs43hd-min.pdf
