Trente ans de recherches en SHS sur le travail*
#NOUVELLES DE L'INSTITUT
La question du travail se trouve ces dernières années au cœur du débat public. Les formes, les conditions, le cadre juridique du travail, les rapports sociaux au travail, le marché du travail, connaissent des mutations profondes, qu’il s’agisse — pêle-mêle — des impacts de la digitalisation, du big data et de l’intelligence artificielle, de la plateformisation, du développement du télétravail, de la transition environnementale ou encore du vieillissement de la population, mutations souvent révélées voire accélérées par la pandémie de Covid-19.
De fait, la France traverse aujourd’hui une grave crise du travail qui, pour certains, « explique en partie l’intensité des réactions à l’annonce du recul de l’âge légal de la retraite de 62 à 64 ans »1 . Les débats sur la réforme des retraites ont mis en évidence des aspirations profondes à mieux concilier vie professionnelle, familiale et personnelle. Le nombre de secteurs sous tension ayant des difficultés à recruter en raison principalement de conditions de travail insuffisamment attractives illustre aussi l’ampleur des enjeux2 .
Dans ce contexte, les enjeux de recherche — le management, le militantisme et le syndicalisme, le sens du travail, la santé au travail, les migrations et le travail, l’éducation et la formation, l’organisation du travail dans l’espace et le temps, sa place dans le parcours de vie, etc. — sont renouvelés en profondeur.
Les travaux des sciences humaines et sociales sont ici particulièrement essentiels pour décrypter et comprendre ce qui se joue à l’échelle des individus, des organisations et plus largement de la société. Ils sont même indispensables pour rendre intelligibles et accompagner les évolutions à l’œuvre et formuler des réponses informées et adaptées, y compris en termes de politiques publiques, pour repenser les formes d’organisation du travail et le management.
C’est fort de ce constat que CNRS Sciences humaines & sociales a, en 2022, mis en place et soutenu un groupe de réflexion pluridisciplinaire sur le travail, dont Thierry Berthet et Delphine Mercier, directeur et directrice de recherche CNRS au Laboratoire d’économie et de sociologie du travail (LEST, UMR7317, CNRS / AMU), à Aix-en-Provence, l’un politiste, l’une sociologue, ont accepté avec enthousiasme d’assurer la coordination.
Le groupe de réflexion s’est vu confier la mission d’établir une cartographie des « forces » de recherche françaises, pour mieux comprendre comment la recherche sur la question du travail s’est structurée, d’identifier ses principaux résultats, les thématiques émergentes et les éventuelles zones d’ombre de travaux portant sur un objet en évolution permanente. À cette œuvre de cartographie s’est adjointe une réflexion d’ampleur, qui restitue autant les enjeux associés au travail et à sa place dans la vie humaine et sociale que sa position comme objet de recherche dans un ensemble de disciplines scientifiques.
L’ouvrage paru chez CNRS Éditions fin 2024, Le travail et la société française, est le résultat passionnant de cet effort collectif. Il met en lumière, à travers une série de courts articles, une somme impressionnante de connaissances, de questionnements et de démarches de recherches. Il permet de comprendre, au-delà de son domaine propre, comment ces champs scientifiques se déploient, se font écho et produisent, ensemble, des connaissances qui ont une certaine cohérence. L’ouvrage montre bien toute la complexité de la question du travail, par la diversité des disciplines, des approches, des méthodes, des objets. Les travaux de recherche permettent aussi de déconstruire des idées fausses qui à force d’être véhiculées par les médias finissent par être tenues pour vraies, irriguer nos politiques et engager le débat public sur de mauvaises bases, comme par exemple l’idée — pourtant bien ancrée — d’un rapport dégradé des jeunes au travail.
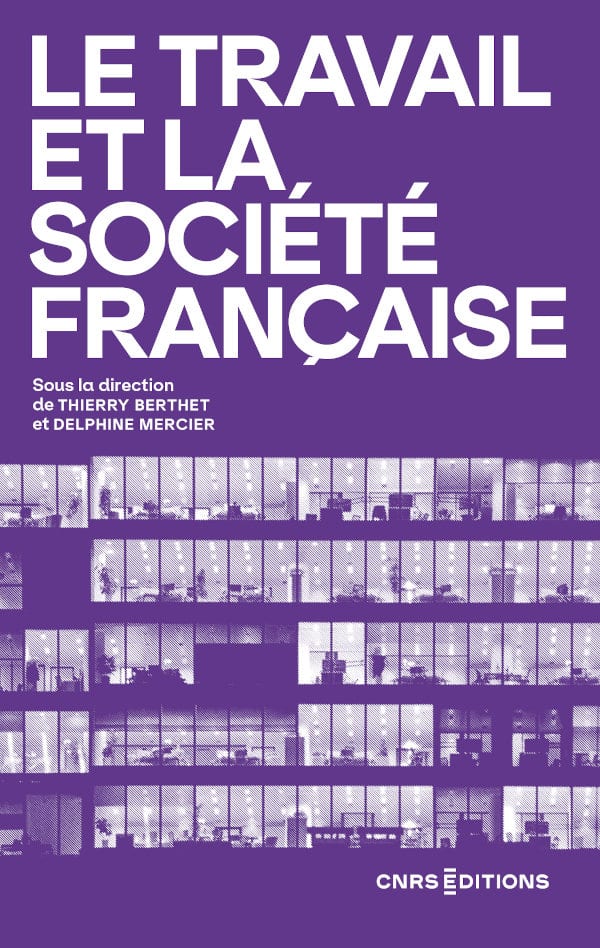
Le travail et la société française met aussi en avant certains points encore aveugles, comme le lien entre expérience professionnelle pendant les études et rapport au travail des jeunes, l’histoire des conditions sanitaires de travail dans l’administration publique, les services ou l’agriculture ou encore l’impact des transitions numériques et environnementales. Face à la faiblesse du dialogue social dans certains contextes nationaux, il est clair que d’autres questions ont été profondément renouvelées et mériteraient une attention plus soutenue dans les années qui viennent, comme celles touchant à la représentation, aux enjeux de démocratie et citoyenneté dans le monde du travail, même si la science politique se saisit désormais du sujet et accorde un intérêt renouvelé à la politisation au et par le travail.
L’ouvrage présente aussi le mérite de mettre en lien, de manière claire, concise et accessible, un ensemble de travaux qu’il contribue ainsi à rendre plus visibles, ce qui est d’autant plus nécessaire qu’ils pourraient et devraient davantage être mobilisés par les décideurs publics là où le discours scientifique a encore malheureusement du mal à percoler vers les acteurs publics.
Loin de l’idée d’une certaine impuissance politique que peuvent véhiculer les médias, Le travail et la société française souligne ainsi opportunément l’étendue du champ des possibles s’agissant des futurs du travail. Il ouvre des perspectives pour penser la place du travail dans la vie humaine, du for intime aux relations sociales et économiques, sa place dans les existences et les façons dont les êtres humains, les familles, les groupes sociaux articulent temps de travail et temps de loisir, vie de famille et mobilités liées à la vie professionnelles, loisirs et travail. Au-delà, il pose encore la question de ce qu’est un travail « soutenable » et s’interroge sur le lien entre travail et pouvoir d’agir.
Le groupe de réflexion a également produit un livre blanc contenant une série de propositions pour mieux structurer et revitaliser la recherche sur le travail, en proposant des mesures à différents horizons temporels (court, moyen et long terme).
L’ouvrage et le livre blanc ont été discutés lors d’un séminaire très stimulant à l’Institut d’études avancées de Paris le 13 décembre 2024, devant un parterre de chercheurs/chercheuses et enseignantes-chercheurs/chercheuses, mais également d’acteurs importants du monde du travail. Ils donnent du grain à moudre à l’équipe de CNRS Sciences humaines & sociales, particulièrement au moment où l’institut se lance dans un exercice de prospective, et nous sommes très reconnaissants à nos collègues Thierry Berthet et Delphine Mercier et à l’ensemble des participants au groupe de réflexion pour l’excellent travail réalisé.
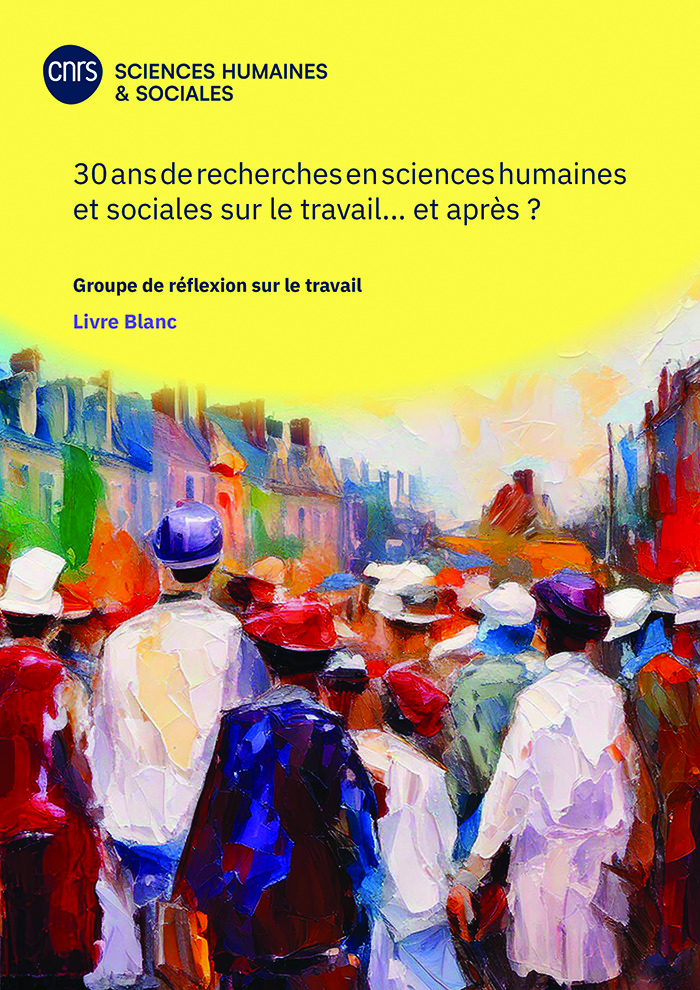
Marie Gaille, directrice de CNRS Sciences humaines & sociales, Sandrine Maljean-Dubois, directrice de recherche CNRS et directrice adjointe scientifique à CNRS Sciences humaines & sociales
* Cet article reprend pour partie la préface de l’ouvrage : Berthet T., Mercier D. (dir.) 2024, Le travail et la société française, CNRS Éditions.
- 1Bigi M., Méda D. 2023, Prendre la mesure de la crise du travail en France, in Palier B. (dir.), Que sait‐on du travail ?, Presses de Sciences Po, pp. 34-50.
- 2Palier B. 2023, « Introduction. Réalités du travail en France », in Palier B. (dir.), Que sait‐on du travail ?, Presses de Sciences Po, pp. 3-19.
