Un anthropologue dans ma famille
#ANTHROPO EN PARTAGE
Devenir gardien d’une mémoire familiale
En octobre 2024, la sociologue Elsa Ramos publiait l’ouvrage Un anthropologue dans ma famille, menez une enquête dont vos grands-parents sont les héros, dont l’objectif était d’accompagner les personnes à mener une enquête sur l’histoire de leur famille avec l’aide d’un grand-parent. Le grand-parent est dépositaire d’une expérience de vie sur un temps long, c’est également celui qui a été en contact avec des ancêtres que le petit-fils ou la petite fille n’a pas connu : les parents et les grands-parents de ses grands-parents ainsi que leurs collatéraux. De ce fait, le grand-parent est un témoin qui permet d’appréhender une temporalité longue qui s’enfonce dans un passé non connu. Il est également un pont qui fait le lien entre les vivants et les morts d’une lignée familiale. Souvent, le désir de connaître l’histoire familiale émerge avec la naissance du premier enfant ou se fait urgent avec le décès d’un grand-parent : chaque génération apparaît alors comme un maillon d’une chaîne. À ces occasions, émerge parfois l’envie de connaitre les vies de ses prédécesseurs et de laisser des traces pour ses descendants : l’envie de devenir un gardien de la mémoire familiale et de la transmettre. Dans certains cas, les grands-parents sont décédés mais d’autres voix peuvent être recueillies : celles de grands-oncles ou de grands-tantes, celle d’un parent, d’une tante, d’un oncle ou de tout témoin dépositaire de traces des existences passées des membres de la famille, l’histoire pouvant se faire à plusieurs voix.
L’envie de faire l’histoire de famille se heurte souvent à des questions : par où commencer ? Comment s’y prendre ? Comment mener l’enquête ? Comment faire parler sur le passé ? Cet ouvrage se veut un manuel pour aider à mener cette enquête dans la famille. Il se présente en deux parties. La première aborde la mise en place de l’enquête : comment s’équiper ? Quelles activités prévoir ? Quel calendrier et quelle organisation adopter ? Quels supports aident à mettre de l’ordre dans les traces recueillies ? Comment faire parler ? La deuxième partie se compose de douze chapitres thématiques (par exemple, l’enfance et la jeunesse ; la formation et la vie professionnelle ; l’amour et l’histoire du couple ; les secrets de famille, etc.) qui proposent chacun un guide d’entretien pour mener à bien les discussions. Pour faire l’enquête, nul besoin de passer en revue les douze chapitres. Il suffit d’en choisir trois ou quatre selon les situations, les envies ou en fonction de ce qui est déjà connu de l’histoire des prédécesseurs et qui peut orienter les entretiens. Si dans chacun des chapitres un thème est dominant, dans les expériences de vie, ils se croisent. Quand un individu parle de son enfance et de sa jeunesse, il y a de grandes chances qu’il aborde également les relations qu’il avait avec ses grands-parents, ses parents, les conditions de vie, les événements qui l’ont marqué, les lieux dans lesquels il a vécu, ils vivaient, etc. Par ailleurs, tout au long de l’ouvrage, des situations et des extraits d’entretiens issus de différentes recherches menées sur la famille et les relations familiales viennent donner chair au propos1.

La méthodologie adoptée : des méthodes des sciences humaines et sociales transposées
La méthodologie adoptée dans l’ouvrage est transposée des méthodes de recherche des sciences humaines et sociales et notamment celles de l’anthropologie et de la sociologie.
Dans l’enquête anthropologique, l’observation participante est centrale: l’anthropologue reste un temps long sur le terrain étudié, condition de partage des pratiques quotidiennes, de réalités d’existence, de compréhension d’un fonctionnement social. Le temps de l’enquête, le chercheur est immergé dans l’univers étudié. Il tente de faire plus ou moins oublier son existence et son identité en essayant de se fondre le plus possible dans l’ordinaire. Le plus ou moins est à questionner : le proche qu’il tente d’être reste quand même un étranger pour le groupe. Les personnes qu’il côtoie lui attribuent des attentes, des rôles, des identités, des intérêts. Aussi, la construction de la connaissance ne peut être dissociée de ces attributions : elles sont partie prenante de ce qu’on lui dit ou pas, de ce qu’on lui montre ou pas.
Dans cet ouvrage, il s’est agi de penser l’inverse : comment passer d’une position de membre de la famille à celle d’un anthropologue de sa propre famille ? La question de la distanciation au terrain est centrale : de membre de la famille, celui ou celle qui fait l’enquête doit se transformer en observateur. Devenir observateur suppose de changer de statut et de faire également changer de statut son grand-parent ou son proche familial et familier. De membre de la famille, il va devenir un individu avec des dimensions d’identités, de vécus que l’apprenti anthropologue de sa famille ne soupçonnait pas : il a fait les quatre cents coups quand il était jeune ? Il a connu des amours autres que le ou la conjointe qu’on lui connait ? D’ailleurs, est-ce une union d’amour ? Il n’a pas été très heureux ? S’est-on déjà même posé ces questions concernant cette figure de la famille ? Il semble tellement être là depuis toujours que cette immuabilité rend difficile une représentation différente de celle qu’on a de lui depuis toujours… Et celui ou celle qui fait l’enquête est-il prêt à faire ce déplacement et à assister à cette métamorphose : voir le grand-parent non plus comme un membre de la famille mais comme porteur de traits d’identités multiples et inconnus ?

Au sein de l’enquête de famille, la discussion et les entretiens ont une place importante. Aussi, se pose la question de savoir comment faire parler et des précautions à prendre dans ces échanges. L’entretien est un outil classique des enquêtes sociologiques. Les enquêtés sont des informateurs précieux et, dans les entretiens, il s’agit de comprendre leurs pratiques, leurs choix, leurs relations et également le sens qu’ils leurs donnent. Un exemple peut illustrer ce propos. Une femme dans un entretien évoque sa grand-mère. Laquelle ? « Ma grand-mère maternelle sinon, je dirais la mère de mon père ! » Son discours et son analyse renseigneront sur les liens avec ces deux femmes et la manière différente de les définir. Si « ses grands-mères » peuvent être situées dans un rang de la lignée et à une place dans la parenté, le sociologue doit creuser ses définitions différenciées qui disent aussi de la conception de la famille dans la société : les histoires ordinaires disent des conceptions, des normes et des évolutions sociales.
Dans l’entretien, il s’agit également de faire preuve de vigilance et de prudence. Dans toute enquête par entretien se pose la question de l’interaction du chercheur et de l’informateur et des discours que produit cette interaction. Se pose également la question des limites : jusqu’où aller dans l’entretien ? Existe-t-il un seuil à ne pas dépasser ? Mais un seuil de quoi ? D’intimité ? De secret ? De souffrance ? Dans une recherche sociologique, un certain nombre de procédures permettent d’assurer le recrutement d’informateurs consentants et l’anonymisation des informations recueillies. Dans le cadre de l’enquête d’un apprenti anthropologue dans sa famille, la protection des informations doit être plus que jamais assurée : de quoi le grand-parent autorise-t-il la divulgation ? Et à qui ? Ces deux questions émergent de l’ouvrage comme garde-fous de l’équilibre familial dont le respect doit faire loi : en famille, toute vérité n’est pas bonne à dire… et à entendre.

De la recherche à une culture scientifique et technique à la recherche
La réalisation de cet ouvrage était un défi : comment mobiliser des éléments de recherche et de méthode en se départissant d’un style académique, de la logique de la preuve et du référencement bibliographique tout en conservant rigueur, questionnements et profondeur analytique ? Comment mettre le lecteur dans une réflexivité permanente, celle du chercheur dans ses enquêtes ? Deux choix d'écriture ont ainsi été faits. Le premier est d’utiliser le « vous ». L’adresse directe au lecteur permet de déployer le propos sous forme d’une discussion, d’introduire des propositions qui tiennent compte d’une diversité de configurations familiales et de situations et de donner des conseils méthodologiques adaptés. Le deuxième choix est celui d’amener des questions tout au long de l’ouvrage en incitant le lecteur à y répondre dans un carnet réservé à cet effet — un carnet de terrain — permettant le déploiement de ses réflexions, de ses questionnements et la conservation de traces de l’enquête. Le retour à la recherche devrait se faire également par l’analyse d’une vingtaine d’histoires familiales en interrogeant l’individualisation de l’histoire familiale. L’histoire et le roman familial sont aussi une histoire et un roman de soi et, selon l’expression commune, « savoir qui je suis c’est savoir d’où je viens ».
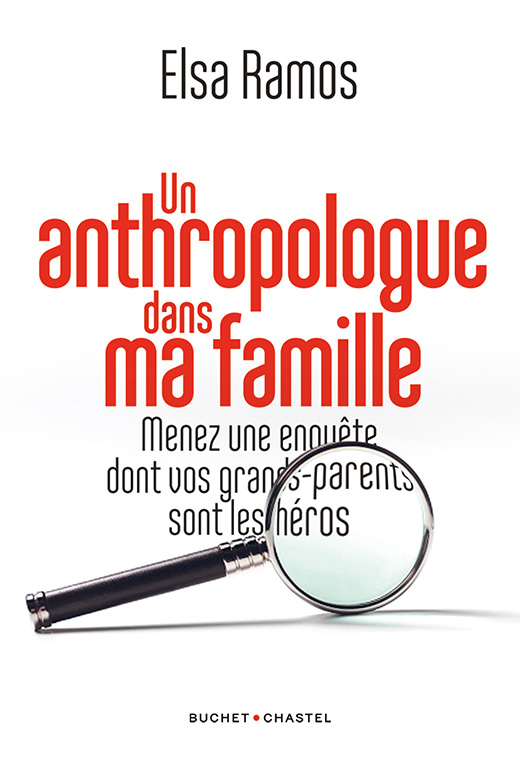
Elsa Ramos, maîtresse de conférences à l'université Paris Cité, Centre de recherche sur les liens sociaux (Cerlis, UMR8070, CNRS / Université Paris Cité / Université Sorbonne Nouvelle)
Référence
Ramos E. 2024, Un anthropologue dans ma famille. Menez une enquête dont vos grands-parents sont les héros, Buchet Chastel.
Aller plus loin
Contact
Notes
- Entre autres : Ramos E. 2002, Rester enfant, devenir adulte. La cohabitation des étudiants chez leurs parents, L’Harmattan, Col. Logiques Sociales ; Ramos E. 2006, L’invention des origines. Sociologie de l’ancrage identitaire, Armand Colin.
